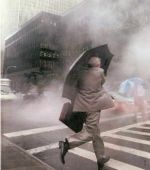LES MOTS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
"Les uns crient à la catastrophe
planétaire si nous persévérons dans nos modes de
vie et de production, les autres à la catastrophe économique
si nous cherchons tant soit peu à les modifier. Qui faut-il croire
? Nous pouvons dégager un certain nombre de réalités,
de faits bien établis, nous pouvons identifier de multiples risques
réels, risques qui s'échelonnent de la quasi-certitude à
la fantasmogorie catastrophiste et au cauchemar. Il ne s'agit pas d'un
exercice purement spéculatif, car nous savons que nos actions affectent
déjà la planète dans son ensemble, et que nos choix
d'agir (ou de ne pas agir) au cours des prochaines années vont
en partie façonner notre avenir. Nous restons entourés d'incertitudes,
et nous ne pourrons guère espérer les éliminer toutes,
même si nous pouvons compter sur de fortes avancées dans
nos connaissances. Il faut néanmoins donner un contenu concret
à ce qui est appelé le "principe de précaution",
peser le certain, le probable et l'improbable, et savoir rejeter les fantasmes
sans pour autant écarter l'éventualité improbable
mais totalement inaceptable."
Robert KANDEL (réd. 2004) Le
réchauffement climatique, le grand risque, Edition PUF,
Paris, "Que Sais-je ?".
DEVELOPPEMENT DURABLE
voir aussi notre dossier "La
notion de développement durable"
Dans un sens premier, développement
signifie dérouler, déployer mais au sens organiciste le
développement signifie davantage la croissance, l'essor, la maturité,
un stade supérieur de croissance atteint, l'épanouissement
(différent de l'idée de progrès).
Durable signifie : constant, permanent, stable, mais aussi profond,
solide ou encore viable, vivant, vif et plus enraciné, persistant,
tenace.
Il semble que la notion de développement durable est polysémique.
Il peut s'agir d'une croissance visant à préserver notre
écosystème, à le maintenir viable, vivant. Il peut
s'agir d'une politique de croissance, d'épanouissement dans une
logique de durée, d'enracinement , d'une logique de développement
dans une logique de constance, de permanence.
Pour un économiste, un écologiste, un homme politique français
et un homme politique américain, le terme de développement
durable n'aura donc pas la même signification. La notion apparaît
suffisamment floue pour être utilisée notamment politiquement
dans de nombreux complexes et pour des objectifs différents (exemple
: "Ministère
de l'écologie et du développement durable".
Le développement durable peut être
défini comme un « modèle de développement économique
et social visant à assurer la pérennité du patrimoine
naturel de la Terre » (encyclopédie Encarta 2003) ou encore
comme un « mode de développement veillant au respect de l’environnement
par une utilisation raisonnée des ressources naturelles afin de
les ménager à long terme» (Petit Larousse 2004).
Petite réflexion sur l’historique
du concept...
Le terme de développement durable a son origine (d’un
point de vue plus linguistique que politique) dans la sylviculture prussienne
du XVIIIième siècle. Selon ce concept, l’exploitation
des ressources naturelles doit veiller à la durabilité de
la qualité et de la quantité des rendements agricoles et
forestiers.
Dans les années cinquante le développement signifie la croissance
et a surtout un sens économique.
Depuis le rapport Bruntdland (1987) où le développement
durable est défini comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs
» la définition s’est enrichie avec, entre autre, le
premier principe de la déclaration de Rio (1992) « Les
êtres humains sont au centre des préoccupations relatives
au développement durable ».
Le développement durable correspond donc à un processus
de développement qui concilie l’écologique, l’économique
et le social : c’est un développement économiquement
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
Source : « Clés pour
une éducation au développement durable » Bruno Riondet,
Hachette éducation, ???.
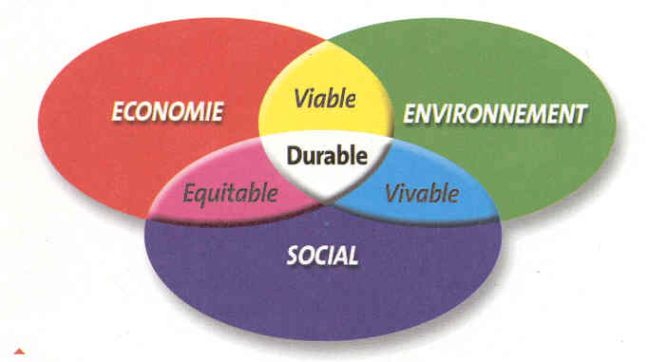
Diagramme en fleur, document BRGM, 2003
ENVIRONNEMENT
voir aussi notre dossier "Définir
l'environnement"
L'environnement est ce qui tourne autour de nous, ce qui agit sur nous,
de virgo en latin (tourner), en allemand l'Umwelt. Le
terme importé des Etats Unis depuis les années 60 pourrait
avoir comme synonyme français le terme de milieu. Ainsi, on pourra
distinguer, l'environnement dans un sens étroit, c'est-à-dire
l'environnement naturel (eaux, air, végétation,
sols, relief,...). L'approche est ici proche du domaine de l'écologie.
Au sens large du terme, l'environnement comporte des éléments
naturels mais aussi des éléments matériels, humains,
des activités, des flux, des cultures, des institutions, des relations.
On peut considérer que c'est tout ce qui nous entoure, un système
complexe qui s'analyse à plusieurs échelles de temps et
d'espace. L'environnement appelle une pensée systémique
de l'espace, des lieux, des territoires.
Sources :
- dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, 1994
- Roger BRUNET, les Mots de la géographie, dictionnaire
critique, Reclus, la Documentation Française, septembre 1993, 518
p.
L’environnement peut être
défini comme l’ensemble des caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques des écosystèmes plus ou moins modifiés
par l’homme (encyclopédie Encarta 2003). Dans ce cas il conviendrait
de définir ce qu’on entend par écosystème.
En s'appuyant sur la définition du Petit Larousse 2004,
l’environnement représente l’ensemble des éléments
physiques, chimiques et biologiques, naturels et artificiels qui entourent
un être humain et un être vivant en général.
Petite réflexion
sur l’historique du concept...
Le mot environnement vient de « virgo » tourner autour et
remonte au XVIième siècle. Vidal de Blache (1856-1918) géographe
français, l’impose au 1921 en tant que terme technique de
la géographie scientifique. Il assure que « l’être
géographique d’une contrée n’est point une chose
donnée d’avance par la Nature, mais un produit de l’activité
de l’homme. »
Ce mot est ensuite abandonné en France, il émigre aux Etats-Unis
où il prend un sens plus large , il ne se rapporte plus seulement
au milieu naturel mais également au milieu humain. Il revient en
France dans les années soixante où il est considéré
comme l’importation du mot « environment ».
Le mot environnement ne désigne plus alors que «
l’ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles
d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines
. » Le terme a perdu sa composante sociale aux Etats-Unis.
Ce mot ne fera son entrée dans le Robert qu’en 1969 .
Source : « Eduquer à l’environnement
» Pierre Giolitto – Maryse Clary Hachette éducation,
????.
Economie de l’environnement...
Branche de la science économique qui
cherche à évaluer les coûts de la dégradation
de l’environnement naturel, les coûts de la dépollution
et de la préservation de la nature, et plus globalement, qui préconise
des politiques environnementales efficaces. L’économie de
l’environnement cherche à concilier l’économie
et l’écologie :
- Comment produire sans détruire de manière irréversible
les ressources naturelles ?
- Peut on évaluer monétairement tous les coûts de
la nature ?
- Comment les internaliser ?
Source : C.D. Echaudemaison, Dictionnaire d’économie
et de sciences sociales, 2003, éditions Nathan, pages p 136 137
MESURES D'ATTENUATION
"Atténuation"
signifie diminuer, réduire, limiter le changement climatique bien
que ce dernier soit irréversible. Dans notre thématique,
cela peut comprendre donc toutes les mesures visant à limiter et
réduire l'impact du changement climatique. Nous sommes actuellement
en recherche de solutions qui visent à diminuer la production des
gaz à effet de serre. Mais comment réduire l’émission
de ces gaz ? L’atténuation concerne donc la réduction
des causes de l’effet de serre (pour la part due à l’action
de l’homme).
On peut grossièrement distinguer plusieurs logiques d'atténuation
:
-
la logique anticipatrice "européenne"
: lutte contre l’effet de serre, logique de prévention
(le risque est " avéré "), ou du moins principe
de précaution,
-
logique malthusienne : "catastrophisme"
-
logique collective : mobilisation
générale
MESURES
D'ADAPTATION
Si on part de l'idée que le changement climatique est irréversible,
malgré des mesures d'atténuation, il est donc nécessaire
de trouver des solutions visant à s'adapter, à "s'acclimater",
à ajuster à la situation nouvelle. On peut ainsi parler
de mesures d'adaptation. Mais la frontière entre atténuation
et adapation semble perméable. En effet, l'atténuation n'est-elle
pas déjà une mesure d'adaptation ?
En ce qui concerne l'aspect énergétique du problème
du changement climatique, on pourra appeler adaptation tous les
moyens mis en œuvre pour limiter les dégâts causés
par un accroissement de l'effet de serre naturel ainsi que l’exploitation
des possibilités nouvelles que ce réchauffement peut offrir
(nouvelles zones de culture adaptées aux nouvelles conditions climatiques,
utilisation de nouvelles voies de communication, transfert de populations…).
Cependant, dans la mesure où nous avons encore beaucoup d’incertitudes
sur comment cet effet de serre va modifier le climat des différentes
régions de la planète, il est actuellemnt difficile de faire
des prévisions précises à l'échelle régionale.
Les mesures d’adaptation sont donc des mesures pour le long terme.
- Aspects philosophiques
(science, technique, industrie, homme, nature, environnement, culture,
vérité, débats, idéologie, faits, valeurs,...)
|