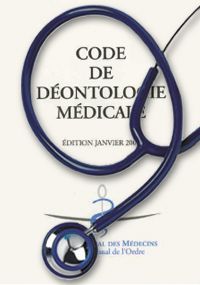Controverses
socioscientifiques :
Quelles communications publiques en matière de santé
et d'environnement ?
Framework
of communication models : deficit, dialogue or participation model ?
Benoît
Urgelli
last
up-date :
8 février, 2014
 |
UE7
Santé, société et humanité Thématique
: VULNERABILITE |
|
Objectifs généraux
Première année commune aux études de santé - UE7. Santé, société, humanité
Bulletin officiel n° 45 du 3 décembre 2009
Par une approche en sociologie, anthropologie, épistémologie et histoire des sciences, interroger l'éthique, la déontologie et les fondements rationnelles et communicationnels des pratiques en situation d'incertitudes et de controverses, face aux risques sur la santé et l'environnement.
Objectifs
spécifiques et Plan de l'intervention
Les
diapositives d'accompagnement de l'exposé
Faculté de Médecine de Lyon-Est
(février
2012)
1.
Partir de la définition grecque des controverses pour arriver
à des définitions liées à deux écoles
de sociologie sur les controverses (en gros les rationalistes et les
relativistes)
2. Montrer les différences d'analyse des controverses sur l'exemple
de la controverse Pasteur-Pouchet dans la recherche
des déterminant sociaux
3. Définir une sociologie des controverses qui s'intéresse
symétriquement (Bloor, 1983) aux déterminants sociaux
et tout autant aux discours, aux pratiques des chercheurs, en tant que
communauté, et à leur éthos (Merton 1973)
4. Quels discours les scientifiques-chercheurs et les praticiens proposent-ils
sur des questions controversées à leurs publics ?
Des discours de rationalité, avec une vision technocratique de
l'expertise (Roqueplo, 1974) et des logiques de communication inscrite
dans l'idéologie de la compétence et dans le deficit model
(Irwin, 2001) cherchant en vain à combler le fossé entre
le savant et l'ignorant. Ces discours soulignent un manque de réflexivité
des chercheurs et des cliniciens (voir l'exemple du discours des praticiens
sur les imageries échographies, qui suscitent de l'anxiété
chez les patients, lorsque les praticiens considèrent les patients
comme des récepteurs passifs alors que ces derniers élaborent
leurs propres représentations en contexte et en fonction de leurs
représentations des sciences et de leurs croyances (Irwin et
Wynne, 1996).
5. Implications pour une communication scientifique socialement partagée
et partageable sur des questions controversées : souligner les
idéologies, les représentations, et les modèles
de communication qui supportent les discours scientifiques. En situation
de controverses, donner une clé de lecture éthique au
sermont d'Hippocrate.
6. Lorsque une controverse se dynamise autour d'un choix politique face
à des risques sur la santé ou sur l'environnement, avec
des jeux d'acteurs et d'arguments visant à la mobilisation citoyenne,
le scientifique qui développe un discours de certitude engageante
risque le discrédit social face aux incertitudes et à
la complexité des questions socioscientifiques. En pariant sur
l'intelligence collective et individuelle, en réconciliant doute
et certitude (Roqueplo, 1993), en communiquant sur l'évaluation
scientifique des risques et la place dynamique des sciences en société,
en prenant en compte la diversité des savoirs, des valeurs et
les territoires d'ignorance, doit-il pour autant renoncer à prononcer
son avis à titre personnel ? Pourquoi ?
Irwin
A., Wynne B. (1996). Misunderstanding Science?: The Public
Reconstruction of Science and Technology, Cambridge University
Press (March 29, 1996), 240 pages. Irwin
and Wynne (1996). p.47, p.1-7 Price
F. (1996). Now you see it, now you don't : mediating science
and managing uncertainty in reproductive
medecine. p. 84-106. Lambert
and Rose (1996), p.80 et 65 Trench
B. (2008). Towards an Analytical Framework of Science Communication
Models. In Cheng, D. and Claessens, M. and Gascoigne, T. and
Metcalfe, J. and Schiele, B. and Shi, S., (eds.) Communicating
science in social contexts: new models, new practices. Springer
Netherlands, pp. 119-138. Jensen
P., Rouquier J.-B., Kreimer P., Croissant Y. (2008). Scientists
connected with society are more active academically. Science
and Public Policy. Irwin
A. (2001). Constructing the scientific citizen : science and
democracy in the biosciences. Public Understanding of Science,
n° 10, p. 1-18. Horst,
M. (2010). Le réseau des cellules souches : une installation
pour communiquer les sciences sociales. Questions de communication
n°17, p. 129-150. Molinatti
G. (2010) Latour
B (2011). "Nous construisons des outils pour évaluer
la recherche". La Recherche, n° 456, octobre
2011, 76-79. Commentaires
personnelles : Il est probable que l'outil permet
de cadriller une diversité de discours et peut etre partiellement
les logiques socioscientifiques associées. Latour renforce
cependant l'illusion que la cartographie complète
des positions controversées médiatisées
construite à partir de la presse internet peut refléter
l'ensemble des positions sociales existantes et contribuer alors
à une objectivation de la controverse. Cette presse développe
probablement une diversité de positions mais qui sont
inscrites dans le contrat de communication médiatique
adopté par le média et relatif aux traitements
de questions socioscientifiques controversées. Par ailleurs,
la représentation des publics proposé
par l'auteur est inscrite dans une forme de déficit model
: " le public [...] reste dans une conception positiviste
de la science selon laquelle il suffit qu’un fait démente
la théorie (par exemple tel refroidissement local) pour
que celle-ci soit invalidée. Il faut changer de vision
et asseoir la confiance envers la science autre part que dans
la certitude positiviste [...] De nos jours, on peut avoir entièrement
confiance dans l’institution scientifique sur cette question
de l’origine anthropique du réchauffement".
Cependant, comme le précise Roqueplo
(1993), un
diagnostic scientifique incertain n’est pas pour autant
un diagnostic auquel on ne fait pas confiance
[...]
Sans la réconciliation entre doute et certitude,
sans la confiance raisonnée et raisonnable dans le travail
des scientifiques, c’est la fiabilité même
des connaissances qui finit par être objet de doute. |
||
12
questions des étudiants de Première année commune
aux études de santé
(envoyées par voie électronique durant
la conférence-débat du Jeudi 02 février 2012, 16h00
- 17h30)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comme l'affirme Dominique Pestre (2007) , les social studies of science britanniques des années 1970 et 1980 ont un objectif avoué – décrire la science telle qu’elle se fait – et dans le même mouvement une cible – les lectures positivistes et scientistes. Ces courants de recherche dénoncent le côté édifiant et tautologique de ces lectures et cherchent à miner les positions d’autorité que les sciences tendent à occuper dans le corps social.
Le positivisme des rationalistes : foi ou raison ?
Le positivisme scientifique considère que le progrès de l’esprit humain est lié au développement de sciences dites positives qui se construisent contre les croyances théologiques et les explications métaphysiques, en cherchant la cause première des choses. En formulant en langage mathématique les lois de la nature et des relations constantes qui unissent les phénomènes par le moyen d’observations et d’expériences répétées, il s’agit d’expliquer la réalité des faits par la rationalité théorique.
La critique religieuse du positivisme porte sur le fait que le positivisme ne permettrait pas de répondre à la question du "pourquoi" des choses. L’encyclique Fides et ratio de Jean-Paul II (1998) se dresse contre la simple factualité et l'opposition de la raison et de la foi, et interroge la capacité que se réservent les sciences à être les seules capables à apprénder le réel.
La critique libérale du scientisme porte sur le fait qu'il amènerait nécessairement au collectivisme puisque la vérité est unique et aucune contestation sociale acceptable. Lorsque des scientifiques expriment une autre explication probable des faits, la lecture positiviste peut conduire à traiter tout scepticisme comme une tentative naïve de relativisme, ou pire....
Premier exemple : les controverses sur l'origine anthropique de l'évolution climatique récente
-
Dans le cas du réchauffement climatique anthropique, on se souviendra des propos de l'économiste indien Rajendra Pachauri, patron du GIEC (le groupement intergouvernemental pour l’étude du climat), envers les dénieurs du réchauffement anthropique. Rajendra Pachauri avait comparé, en 2004, l’attitude du statisticien Lombjorg à celle d’Hitler, pour sa manière de faire disparaître les êtres humains derrière des chiffres :
| Pachauri compared Bjørn Lomborg, Danish statistician and author of The Skeptical Environmentalist, to Adolf Hitler in an interview with Jyllands-Posten, a leading Danish newspaper (published April 21, 2004). | "What is the difference between Lomborg's view of humanity and Hitler's? You cannot treat people like cattle. You must respect the diversity of cultures on earth. Lomborg thinks of people like numbers. He thinks it would be cheaper just to evacuate people from the Maldives, rather than trying to prevent world sea levels from rising so that island groups like the Maldives or Tuvalu just disappear into the sea. But where's the respect for people in that? People have a right to live and die in the place where their forefathers have lived and died. If you were to accept Lomborg's way of thinking, then maybe what Hitler did was the right thing." |
The British scientific journal Nature, in November 8, 2001, published a review of The Skeptical Environmentalist by Stuart Pimm of the Center for Environmental Research and Conservation, Columbia University, and Jeff Harvey of the Centre for Terrestrial Ecology, Netherlands Institute of Ecology. Stuart Pimm; Jeff Harvey (2001). "No need to worry about the future". Nature, vol. 414, p. 149-150, November 8, 2001. |
"The text employs the strategy of those who, for example, argue that gay men aren't dying of AIDS, that Jews weren't singled out by the Nazis for extermination, and so on." |
| Godwin's Law of Nazi Analogies In Iain Murray, Adolf Lomborg? May 11, 2004. | As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one [...] Godwin's Law and its variants teach us many things. They teach us that genuine debate is not well served by Nazi analogies. They teach us that those who employ Nazi analogies usually have either weak arguments or are too emotionally invested in the subject to be dispassionate on the issue. And they teach us that those who see Nazi analogies being employed are liable to trust those who use them less. |
Voir également
le portrait de Vincent Courtillot publié par le journal
Libération,
dans son édition du 13 mai 2010, |
[...] "En 2004, le leader mondial des «carbocentristes», Rajendra Pachauri, trouvait soudain des similitudes entre la vision du monde de Bjorn Lomborg, une figure du climato-scepticisme, et celle… d’Adolf Hitler. Le débat sur le réchauffement venait d’atteindre ce que les internautes appellent le «point Godwin», à savoir cet instant où toute discussion devient impossible entre deux camps qui commencent à se traiter de nazis. C’est vers cette époque que Courtillot s’est mis en tête de se pencher sur les évolutions du climat [...]. |
-
le "moi je suis physicien" de Bernard Legras.
-
Voir également Schneider (2010) sur la neutralisation des sceptiques
-
les propos du physicien Harold Jeffreys en 1924 contre la tectonique des plaques "out of question" : « Il n'y a par conséquent pas la moindre raison de croire que des déplacements en bloc de continents à travers la lithosphère soient possibles. […] Une dérive séculaire des continents, telle qu'elle a pu être soutenue par A. Wegener et autres, est hors de question. »
-
voir les propos de Francis Bacon (1620), cité par Alan Sokal (2005, Pseudosciences et postmodernisme: adversaires ou compagnons de route ? p.119) : ce philosophe avait déjà remarqué la complémentarité des continents. Il s'était servi des cartes imprimées à St-Dié en 1507 pour fabriquer le premier planisphère utilisant la projection de la sphère Terrestre en fuseaux.
- le cas de l'évolution et du créationnisme
Deuxième exemple : la controverse Pasteur-Pouchet ou l'histoire d'une controverse sur les déterminants des controverses !
Dominique Raynaud (2003, p.45-80) propose de reprendre les analyses de Bruno Latour (1989) autour du débat visant à départager les hypothèses suivantes : un être vivant est toujours issu de parents (HOMOGENIE) ou non (HETEROGENIE), et les expériences imaginées pour tester ces hypothèses par Pouchet (qui publie Hétérogénie ou Traité de la génération spontanée en 1859) et Pasteur (homogéniste).
Raynaud signale que le trait le plus frappant de cette controverse est une dynamique périodique : de 1859 à 1862, Pasteur expérimente et Pouchet critique, puis les rôles s'inversent de 1862 à 1864. Les deux évènements sont séparés par un évènement important : l'attribution du prix Alhumbert à Pasteur le 29 décembre 1862.
En appliquant le principe de symétrie (Bloor, 1983) dans l'analyse des correspondances des acteurs, Raynaud se propose de tester l'hypothèse selon laquelle une controverse se cloture lorsque des asymétries s'accumulent entre les acteurs, tout autant sur les plans scientifiques que sociopolitiques. Il se détache de l'approche de Latour qui selon lui, ne prend pas en compte les contenus scientifiques en jeu mais cherche plutot les étapes de construction du consensus sans porter du jugement sur les contenus (Raynaud, 2003, p.50).
CONTROVERSE
sur la génération spontanée |
Pasteur un être vivant est toujours issu de parents (HOMOGENIE) |
Pouchet |
Enquête
de Raynaud (2003) |
|
Déterminants sociopolitiques d'asymétrie selon Latour (1989) et Vinck (1995)
Déterminants socioscientifiques d'asymétrie selon Raynaud (2003) |
Parisien |
Provincial
rouennais |
L'image
d'un milieu parisien a priori hostile au provincial Pouchet résulte
d'une analyse pour le moins superficiel (p.51) l'opposition n'a
pas de signification intrinsèque |
Membre
de l'Académie des sciences |
Correspondant
|
Pouchet
élu en 1849, avait des relations suivies avec les membres
de l'académie Pasteur élu en 1862. L"Académie des sciences n'est pas un corps indivisible : elle se caractérise par une grande diversité d'origine sociale, d'âge et d'opinion politique. |
|
Proche
de l'Empereur |
Eloigné
|
Napoléon
III n'est pas intervenu dans l'affaire. |
|
Chercheur
de mauvaise foi (éthique scientifique discutable) |
Chercheur
de bonne foi (éthique scientifique irréprochable) |
Pasteur
(1864) aurait associé la position de Pouchet à celle
d'un athée en déclarant : "Il n'y a ici ni religion,
ni philosophie, ni athéisme, ni matérialisme, ni spriritualisme
qui tienne [...] C'est une question de fait". La correspondance
de Pouchet montre toutes les armes (licites ou non) utilisées
pour écraser son rival : "ce charlatan, ce farceur,
cet illuminé [...] qui s'égare et produit des élucubrations
embrouillées ou de ridicules expériences, de vielleries
chimiques" |
|
Chercheur
avec des préjugés |
Chercheur
qui apporte des preuves empiriques pour soutenir ses positions |
d'après
Vinck (1995, p.113), mais Raynaud démontre l'inverse. |
|
Chercheur
dilettante |
Chercheur
professionnel |
Pasteur
effectuait ses recherches sur la génération spontanée
hors d'un laboratoire, alors qu'il est directeur des études de l'Ecole normale (asymétrie de statut qui explique les réactions de Pouchet) |
|
Chercheur
jeune (37 ans) |
Chercheur
confirmé (60 ans) |
On
doit effacer de la controverse tout ce qui porte à imaginer
un déat entre en grand savant et un inconnu, puisque durant
cette période Pouchet jouissait d'une plus grande notoriété
sur les questions de biologie. Pasteur attaque donc les travaux
de son ainé, remporte trois prix de l'Académie des
sciences, alors que Pouchet reste correspondant. Pouchet a probablement
mélé rancouer et jalousie au traitement de la question
scientifique. |
|
Chercheur
peu productif |
Chercheur
productif |
En 1864, Pasteur à 35 publications et Pouchet 76 publications. la productivité ne constitue pas toujours un facteur de succès scientifique. Pasteur communiquait des notes de synthèse, alors que Pouchet était un développeur. | |
| Ecrit
scientifique dans un style démonstratif d'un chimiste |
Ecrit
scientifique dans un style illustratif d'un naturaliste |
Textes
de Pasteur denses et faisant une démonstration économe,
alors que Pouchet développe de longs commentaires, avec
des arguments d'autorité qui viennent comblés les
lacunes de la démonstration expérimentale |
|
Attitude
sceptique vis à vis de l'activité scientifique (scepticisme méthodique) |
Attitude
dogmatique et fanatique vis à vis de l'activité scientifique |
Pasteur
est sceptique à l'égard de toute solution préétablie,
Pouchet est convaincu a priori par l'hétérogénie
(digmatisme) et ne doute pas de ses forces et de la science sacrée.
Il est (constat diamétralement opposée à celui de Vinck) |
|
Chercheur
probe |
Manipulateur
|
Prisonnier
de ses convictions, Pouillet a falsifié des documents, violant ainsi la déontologie scientifique (démonstration sur la base d'une analyse stylistique de lettres). |
Sa conclusion est sans appel (p. 70) : Pouchet (scientifique faible mais socialement puissant) a transgressé à plusieurs reprises les normes de l'éthos scientifique, par son dogmatisme, sa préférence marquée pour les débats dans les forum officieux (presse généraliste) et même la falsification de documents. Dans cette controverse, les descriptions relativistes des asymétries occultent des nuances. Des asymétries pourtant cruciales du point de vue sociologique sont passées sous silence. Pourquoi de telles différences ?
Selon Raynaud, Latour fait un usage pour le moins personnel du principe de symétrie de Bloor (1983) : les vainqueurs d'une controverse n'ont pas besoin d'être protégés par l'historien, mais seulement les vaincus, auxquels on donnera [...] une seconde chance devant le tribunal de l'histoire (Latour, 1989, p.430). L'idée est donc de sortir d'un récit historique jugée (Pestre, 2006) mais on risque alors de sortir d'un programme d'analyse qui cherche à expliquer les croyances "vrais" et "fausses" de la même façon par l'application d'un principe d'impartialité, vis à vis de la vérité ou de la fausseté, de la rationalité ou de l'irrationalité, du succès ou de l'échec (Bloor, 1983, p.8). Or la volonté de protéger les vaincus échappe au principe d'impartialité ! (Raynaud, 2003, p.71). Par une forme de jugements de préférence qui appartient à la philosophie des valeurs et non à la méthode des disciplines empiriques (Weber, 1964, p.428), le sociologue relativiste risque ici de créer des asymétries en préférant Pouchet à Pasteur.
Il constate également que le point faible de l'analyse relativiste est de s'appuyer sur un compte-rendu de Pennetier, disciple de Pouchet, écrit en 1907 et qui souligne l'existence d'une lettre d'Isodore Geoffroy de Saint Hilaire expliquant que le prix de l'Académie a été institué pour honorer les travaux de Pouchet.... Mais Raynaud démontre que cette lettre est un faux...et tous ceux qui se sont fondés sur cette relation dans leurs analyses aboutissent à des interprétations discutables.
Pouchet est sorti vaincu aussi pour des raisons déontologiques, en essayant de résoudre des questions de biologie par des procédures extérieures (campagne de dénigrement, appel au ministre et à la Presse), il s'est éloigné des normes de désintéressement et de scepticisme organisé (Merton, 1973, p. 275-277).
Un conditionnement religieux des sciences ?
Selon Latour, la réfutation de la génération spontanée (l'hétérogénie de Pouchet) peut être mise en relation avec la querelle entre le transformisme et le créationnisme. La résolution de la controverse aurait donc un fondement théologique. Pour Vinck -1995, p.114), ni la théorie de la génération spontanée, ni la théorie darwienienne [...] n'était politiquement acceptable. Aussi, l'élite scientifique du pays avait-elle besoin d'arguments pour rejeter ces théories matérialistes.
Les sociologues répètent le partage entre matérialistes et spiritualistes, radicaux et conservateurs, évolutionnistes et créationnistes... mais certains pensent que les facteurs idéologiques conditionnent le débat scientifique (société--->science), là où d'autres postulent que l'idéologie récupère les résultats scientifiques (science--->société). Raynaud se propose de tenter de préciser le sens de la détermination de cette relation science/société, en reprenant l'analyse des facteurs sociaux. Dans notre exemple, il s'agit de revenir sur la proposition relativiste selon laquelle la génération spontannée fut un argument de l'évolutionnisme plutot qu'un argument des créationnistes.
Pasteur
préexistence de germes |
Pouchet
génération spontannée |
|
Hypothèses
sur le conditionnement idéologique
|
argument
scientifique justifiant le créationnisme |
argument
scientifique justifiant l'évolutionnisme |
académicien
conservateur, spiritualiste catholique, fixiste et créationniste |
radical,
matérialiste, darwiniste, évolutionniste |
|
Analyse
de Raynaud |
Pasteur
(1864) sépare les questions de science et les questions
de croyance et de sentiments : |
Pouchet
étaye la thèse de l'hétérogénie
par des preuves de son orthodoxie religieuse. il se déclare
adversaire au darwinisme et adhère au fixisme et au créationnisme. |
L'association des thèses scientifiques avec des idéologies politiques ou religieuses est donc ambigue. D'ailleurs, les partisans scientifiques de l'hétérogénie depuis le XVIIe siècle, pas plus que leurs adversaires, n'ont formé une famille homogène : certains attaquèrent la génération spontannée, qui reconnait le rôle du hasard et menace le plan créationniste, en fonction d'a priori religieux. On trouve autant de vocations religieuses à défendre l'hétérogenie tout en étant un adversaire déterminé des idées de Darwin sur la sélection naturelle. La dichotomie proposée par certains sociologues pour rendre compte de la dynamique des controverses est donc insuffisante. Les associations entre évolutionnisme et génération spontanée ne présente donc pas de caractère de nécessité. Le portrait de Pasteur créationniste résulte donc d'une corrélation discutable sur les déterminants des contenus scientifiques, ou d'une erreur d'appréciation qui repère des influences sociales là où il n'y en a pas. (Raynaud, 2003, p. 76).
Théologie et génération spontanée
A
une époque où l'alternative évolutionniste n'avait
pas été concue, la croyance hétérogéniste
concernait certaines catégories du vivant : pour Aristote (De
generatione animalium, III, p.11) , il s'agit des insectes, des mollusques
et de certains poissons. Au XVII, la thèse se limite aux insectes,
puis à partir du XVIIIe siècle, elle ne concerne plus que
la génération des micro-organismes. En dépit de ce
changement d'échelle, on retrouve les mêmes hypothèses
: certains êtres pourraient naitre spontannement à partir
de milieux riches en matière organiques sous l'effet de certains
adjuvants (comme la chaleur ou la lumière).
Avant de subir la révolution évolutionniste, la thèse
de la génération spontannée va subir une première
révolution qui l'a fait passer d'une thèse fixiste (les
espèces sont les mêmes de toute éternité) à
une thèse créationniste (elles sont les mêmes depuis
qu'elles ont été créées par Dieu) : on tente
de rapprocher la thèse de la génération spontanée
du scénario biblique. Ce que tentera Pouchet, en s'appuyant sur
les textes de Saint Augustion (De genesi ad litteram, III, p.19)
(cité par Raynaud, p. 77-78) : Dieu aurait créé simultanement
plusieurs semences, dont certaines se sont développées ultérieurement.
La génération spontannée pouvait encore au XIXè
siècle recruter des partisans parmi les théologiens.
Conclusions
Pour
Raynaud, le principe d'une absence de démarcation entre science
et non-science, une démarcation dénoncée par Latour
(2011), produit pourtant une transgression lorsque les science studies
font peser des déterminants politiques et religieux dans la controverse.
Le principe des asymétries cumulées est intéressant
mais l'analyse n'aurait de sens que si elle se limitait à un individu
(Pasteur, catholique, conservateur et homogéniste). Mais
dès qu'on examine une famille d'acteurs homogénistes, on
constate une grande diversité de positions qui ne donne à
la corrrespondance supposée entre homogénie, opinion politique
et obédience religieuse aucun pouvoir explicatif véritable.
Le rôle exact des facteurs sociaux dans la dynamique des controverses
est donc posée : car plus la population est grande, et plus une
corrélation qui semble déterminante à l'échelle
d'un individu devient insignifiante.
Raynaud
énonce alors TROIS principes pour une analyse sociologique des
controverses :
1.
la recension des asymétries doit distinguer les arguments en fonction
des forums (constituants ou officieux) sur lesquels ils apparaissent.
2. La recherche des asymétries doit être aussi exhaustive
que possible, car l'explication de la controverse dépend de leur
sélection
3. Cette recherche doit être conduite sur une famille de chercheurs,
de manière à ne pas tenir pour typiques des corrélations
personnelles ou fortuites.
-
GIORDAN, A. et RAICHVARG, D. (1987). De la découverte... à la compréhension des concepts. In GIORDAN, A., RAICHVARG, D. et al., Histoire de la Biologie, tome 1, Paris : Technique et Documentation / Lavoisier (pp 1-31).
-
RAICHVARG, D. (1987). Histoire du concept de microbe. In GIORDAN, A., RAICHVARG, D. et al., Histoire de la Biologie. tome 1, Paris : Technique et Documentation / Lavoisier (pp 91-198).
Les formes scientistes de l'expertise technocratique
Pour les scientistes, la connaissance scientifique permettrait d’échapper à l’ignorance dans tous les domaines et d’organiser scientifiquement l’humanité. Le politique s’efface donc devant la gestion purement rationnelle des problèmes sociaux et on aboutit à une forme de gouvernement où la place des techniciens spécialisées dans un domaine est centrale dans les prises de décision (exemple de l'expertise technocratique des risques climatiques). Le pouvoir doit être confié à des savants dans le cadre de l'idéologie de la compétence (Roqueplo, 1974) et de l'existence d'un univers des savants face à celui des ignorants, d'un univers de la raison contre celui de l'opinion ((démarcation entre sciences et sociétés). Le risque d'une approche scientiste de l 'expertise est de déboucher sur la négation de la démocratie, une confiscation du pouvoir de décision en relation avec les savoirs, et sur un manque de transparence sociale pour le soi-disant ignorant.
Dans ce contexte, le scientiste considère que toute expression sceptique relève alors de l’ignorance ou d’une volonté de nuire. Seules les connaissances scientifiquement établies sont vraies, ce qui renvoie à un excès de confiance en la science qui se transforme en dogme.
Quelle place pour l’éducation scientifique dans l'approche scientiste ?
Pour certains, l'éducation scientiste permettrait alors de libérer le plus grand nombre des illusions métaphysiques et théologiques, voire même de lutter contre l'intrusion religieuse dans l'enseignement comme dans le cas du créationnisme. Les scientistes divergent cependant sur les stratégies de lutte contre ces intrusions métaphysiques.
Pour certains, c'est l'évitement voire la censure des discours créationnistes qui est recommandé : l'enseignement ne doit pas perdre de temps à démontrer que la parthenogène n'existant pas chez les mammifères, il est hautement improbable que la Vierge Marie est enfanté de Dieu, ou à convaincre que le principe d'Archimède n'est pas compatible avec l'idée de marcher sur l'eau (sauf sur un lac gelé). (communication personnelle de Dominique Larrouy, 28 juin 2010).
Pour Bernard Legras (communication personnelle, 17 mars 2010) : le doute est respectable mais tout doute n'est pas également éligible à considération. Il existe une minorité, au moins aussi nombreuse et vociférante que les climato-sceptiques, et comprenant des universitaires dans divers pays, qui considère que la Terre et l'univers ont été crées il y a 6000 ans. Allez-vous pour autant laisser une place au créationnisme dans vos cours de géologie ? Ou pensez-vous que la science de la datation isotopique soit plus sérieuse que la spectroscopie moléculaire. J'ose la comparaison car la qualité de l'argumentation et la malhonnêteté intellectuelle actuellement en vigueur dans la campagne anti-GIEC sont à peu près de même facture.
Cependant, lorsqu'il y a des enjeux sociaux comme dans le cas des médecines alternatives, de l'alimentation bio, certains positivistes acceptent que l'instution scolaire s'investisse dans une approche rationaliste visant à dénoncer les formes pseudoscientifiques de certains discours.
Pour ou contre une approche relativiste ?
Le sociologue des sciences Steve Fuller propose de destituer la science de sa position hégémonique en matière épistémologique. Concernant la controverse sur l'enseignement du créationnisme à côté de l'évolution dans les écoles publiques américaines, Fuller (1996, pp. 48-49) fait une observation pédagogique judicieuse selon Alan Sokal (2005) : "compte tenu du fait que les deux tiers de ceux qui croient à l'évolution croient également que cette dernière est le reflet de l'intelligence divine, il me semble qu'en niant ex cathedra [les idées théologiques] , on méconnait le point de départ intellectuel de l'écolier moyen ". Pourtant loin d'en tirer les conséquences pour un enseignement impartial mais engagé vers une lecture rationaliste (à savoir mettre en cause les préjugés des élèves et leur enseigner l'analyse critique des preuves empiriques), Fuller fait preuve d'une forme de relativisme naïf et soutient que l'on doit conforter ces préjugés chaque fois que possible : afin de protéger la liberté d'investigation des élèves, les enseignants devraient essayer, chaque fois que cela est possible, de leur montrer qu'on peut arriver aux mêmes résultats en partant de présupposés théoriques différents. Pour Sokal (2005, p.140), qui s'exprime clairement contre cette approche relativiste du créationnisme, une telle démarche des controverses qu'on pourrait qualifier d'impartiale et de neutre, ne protège nullement la liberté d'investigation des élèves, mais plutot la liberté des parents d'empêcher les élèves de se poser des questions.